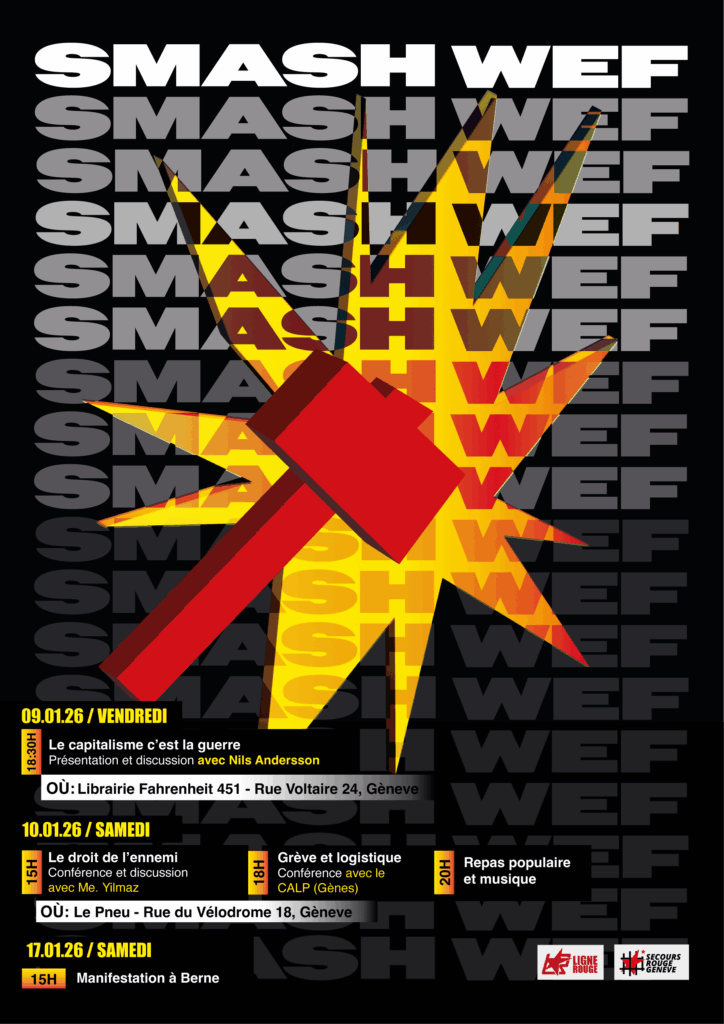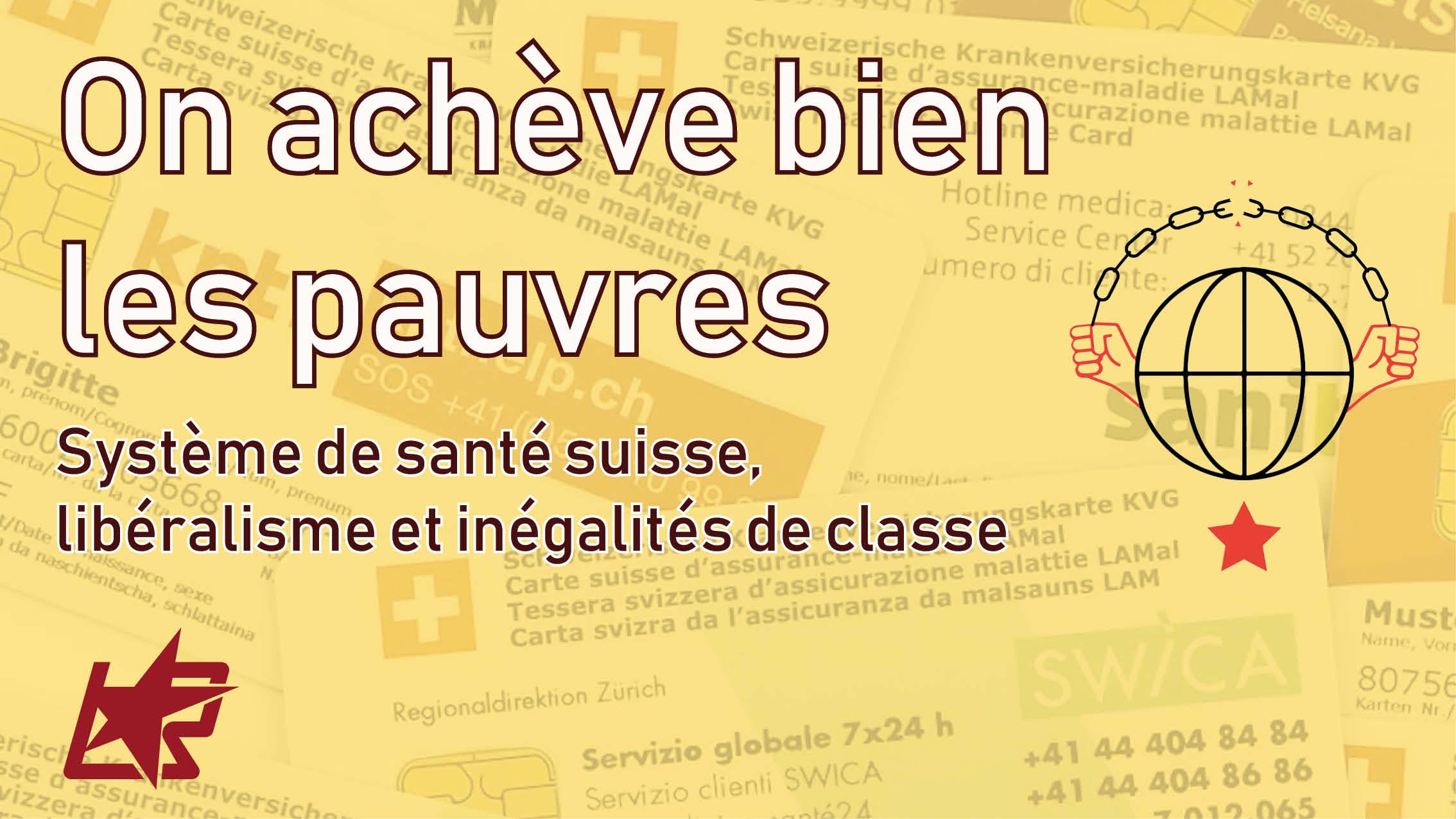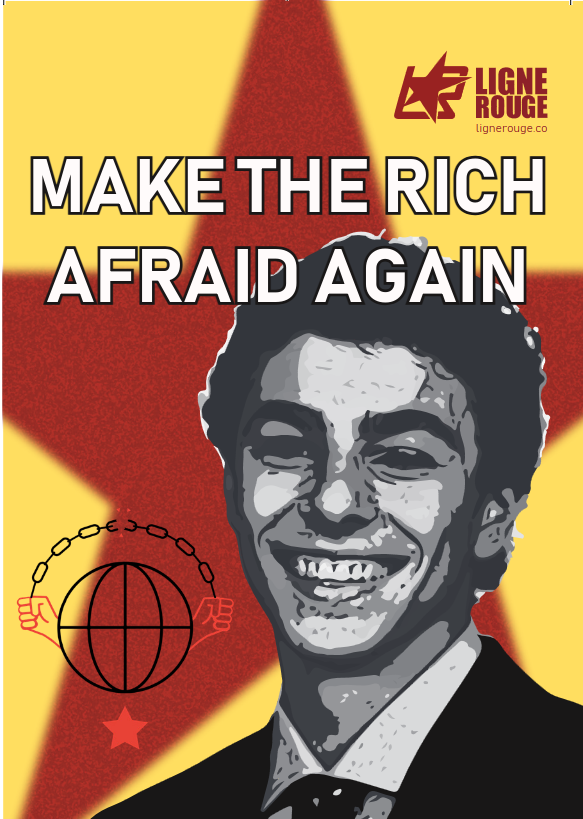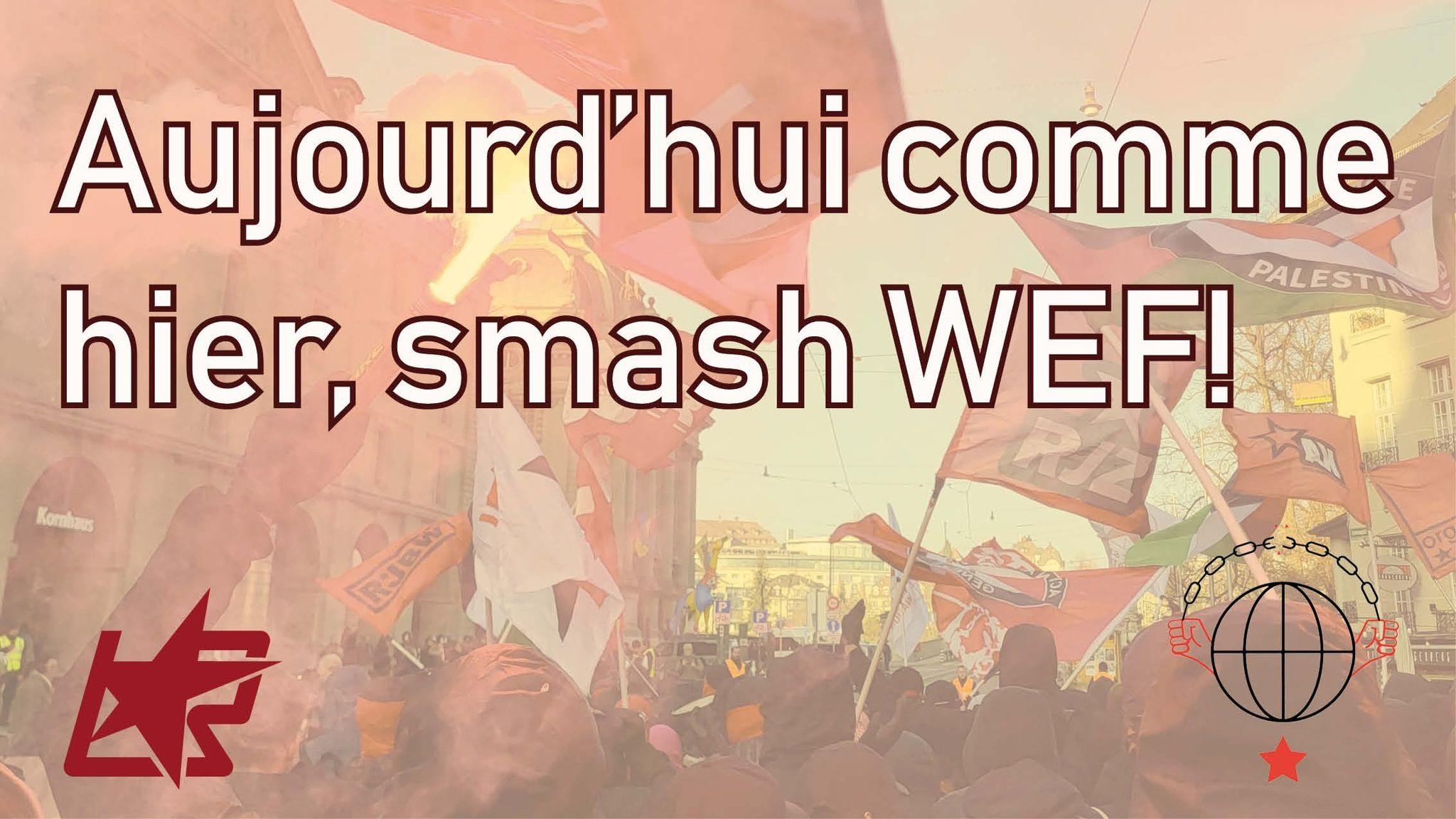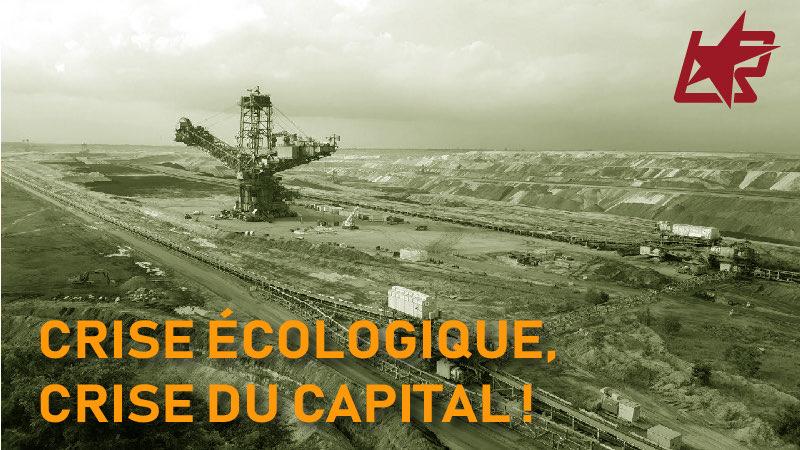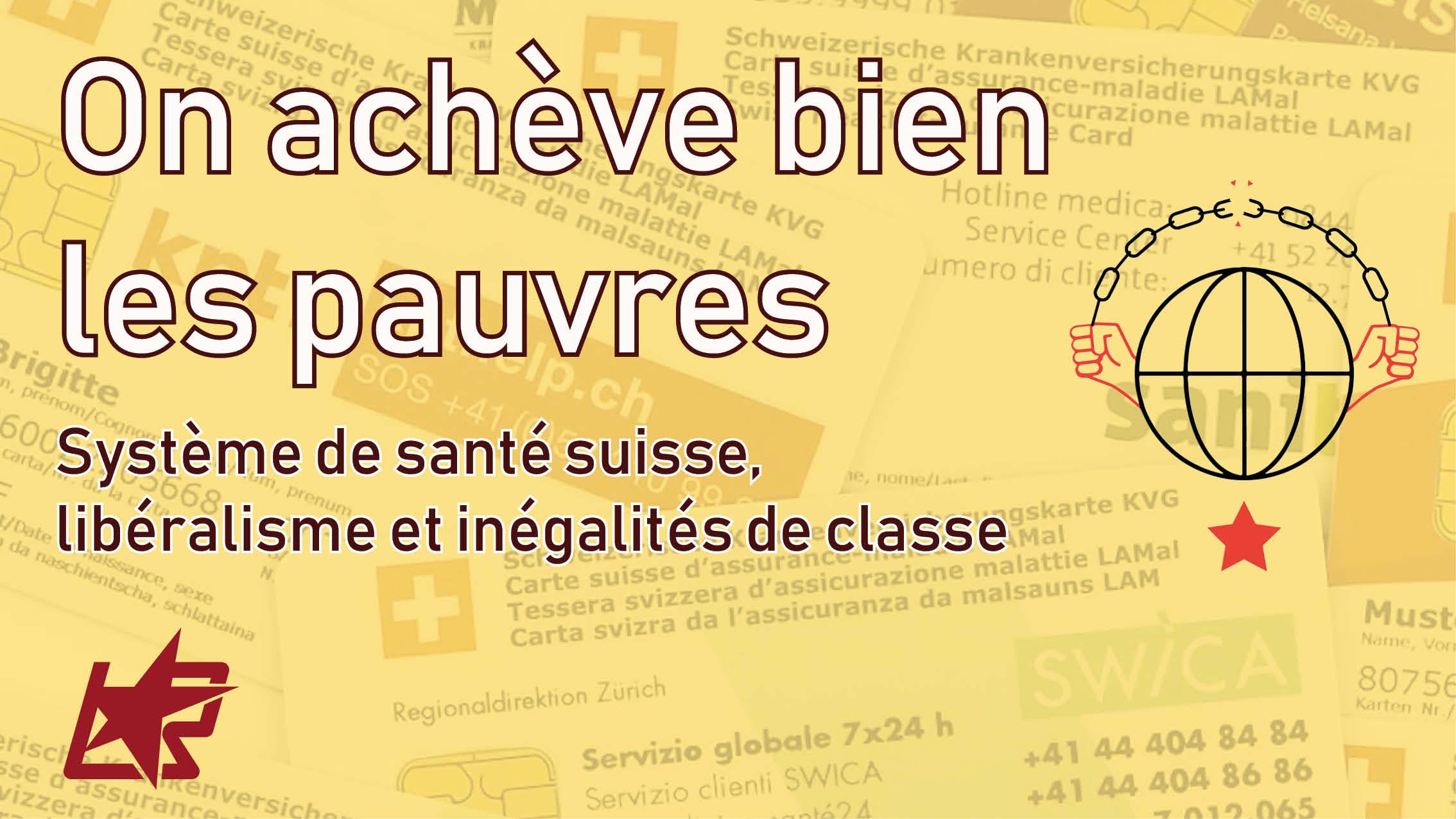
« Dormir assez, bouger régulièrement, rire, entretenir ses amitiés ». Avec ces injonctions à une vie saine et heureuse, les campagnes publicitaires des assurances maladie de ces dernières années semblent s’être transformées en opération de développement personnel à destination des assurés. Ceux-ci sont priés d’y mettre du leur pour garder la forme (et ne pas leur coûter trop cher): la santé serait un capital individuel qu’on entretient, une responsabilité personnelle. Comme si se maintenir en bonne santé était un choix accessible à tou.te.s, qu’il suffisait d’un peu de bonne volonté et de quelques exercices de respirations.
A l’inverse de cette propagande niaise et hypocrite, malgré une médecine « de pointe » réputée pour sa performance, la Suisse est loin d’être un pays où l’accès à la santé est aisé et abordable. Contrairement à de nombreux pays qui optent pour un système de santé sur le modèle du service public, la Suisse possède un système de santé très libéral dont le financement repose en grande partie directement sur la population elle-même. Malgré les centaines de francs que nous investissons chaque mois dans l’assurance maladie, nous soigner convenablement semble de plus en plus hors de portée. Entre le coût des soins et les risques plus élevés de souffrir de maladies chez les personnes plus défavorisées, la santé est un domaine où les inégalités de classe sont particulièrement exacerbées.
Inégalités de santé et classes sociales
Car pendant qu’elles se targuent d’oeuvrer pour le bien commun en nous conseillant de mieux dormir, les assurances maladies et leur système de remboursement entravent l’accès le plus basique aux soins. Un assuré contraint d’opter pour la franchise la plus haute y réfléchira à deux fois avant de consulter, sachant que les soins sont chers et qu’il devra payer de sa poche. Ainsi, les statistiques du renoncement aux soins en Suisse sont vertigineuses: certaines études estiment que jusqu’à 20% de la population renonce à des médicaments ou des consultations médicales jugées nécessaires par manque de moyens financiers. Ce chiffre monte à 28% concernant les soins dentaires, qui ne sont pas remboursés par l’assurance de base.
Les primes d’assurance maladie ont augmenté de 159% en 20 ans. En 1999 la franchise maximum était de 1500chf; aujourd’hui, un tiers des assurés opte pour la franchise actuelle la plus haute à 2500chf. Concrètement, les personnes les plus pauvres paient de plus en plus cher leurs primes d’assurance tout en sachant que celles-ci seront parfaitement inutiles quand il s’agira de rembourser leurs soins les plus basiques. Comment fait-on lorsque beaucoup d’entre nous ne peuvent simplement pas se permettre de tomber malade? Le système de santé suisse laisse pour compte les franges les plus pauvres de sa population, non sans extorquer des sommes faramineuses de leurs poches tous les mois.
Au-delà du coût des soins et de l’assurance maladie et des inégalités qu’ils engendrent, nous ne sommes pas non plus tous égaux face au risque de problèmes de santé. Les statistiques qui comparent niveau de revenu et problèmes de santé sont claires: notre appartenance à une classe sociale a une influence sur notre niveau de santé et les problèmes de santé auxquels nous risquons d’être confrontés dans notre vie.
Pour exemple, d’après les statistiques de l’Office Fédéral de la Santé Publique, les classes les plus pauvres ont beaucoup plus de chances d’être touchées par l’hypertension, le diabète, le cholestérol, les douleurs au dos, l’arthrose, les douleurs aux articulations, etc. Les personnes les plus défavorisées sont beaucoup plus à risque d’être inactives physiquement, en surpoids, fumeuses, et d’avoir une alimentation moins saine. De même, si la longévité augmente et que les personnes âgées vivent plus longtemps, ces années supplémentaires correspondent plus souvent à des années de maladie pour les pauvres, alors que les plus favorisés passent leur fin de vie en meilleure santé. Même constat en ce qui concerne la santé mentale: les personnes avec un statut social bas sont deux à trois fois plus à risque d’être en détresse psychologique que les personnes avec un statut social élevé.1
Cela montre que notre santé n’est pas qu’un choix individuel et dépend en grande partie de nos conditions matérielles d’existence: il est plus difficile pour un ouvrier qui se casse le dos au travail 42h par semaine d’aller faire du yoga pour se détendre les lombaires, ou pour une mère célibataire avec 3 enfants à charge de « mieux dormir », d’être moins stressée ou de manger moins de repas surgelés. Les statistiques le montrent, un mode de vie sain n’est souvent pas un choix mais un luxe. Nos conditions de travail, de logement, le temps libre que nous avons à disposition, nos moyens financiers impactent directement notre santé. En définitive, celles et ceux qui sont le plus exposé.e.s à des soucis de santé sont aussi celles et ceux qui ont le plus de peine à se payer les soins nécessaires pour y faire face.
Ce mythe du « choix individuel » n’est là que pour éclipser le fait que la santé est un fait social, que sa responsabilité est collective et que c’est à nos politiques et au système de santé que de garantir l’accès à de bonnes conditions d’existences et à des soins abordables.
Le business lucratif de la santé en Suisse
La santé en Suisse est un secteur de l’économie libérale comme un autre. Son objectif premier est le profit, et non la santé de la population. Bien que l’assurance maladie soit en partie réglementée (par exemple par l’interdiction de faire du profit sur l’assurance de base, contrairement aux complémentaires) et que les cantons participent financièrement à certains coûts (par exemple les hospitalisations), le secteur de la santé reste globalement livré aux aléas des lois du marché, répondant au modèle de l’offre et de la demande, soumis à la nécessité d’engraisser les actionnaires et certains cadres et professionnels haut placés.
Par exemple, la Suisse est à la pointe de l’industrie pharmaceutique. Grâce au système des brevets qui leur garantissent un monopole, les grandes entreprises pharmaceutiques engrangent des milliards de bénéfice sur les médicaments qu’elles développent et sont les seules à pouvoir produire et commercialiser sur une durée de 20 ans. Elles peuvent à leur guise vendre leurs traitements au prix fort, et c’est aux assuré.e.s, via leurs primes, de passer à la caisse pour financer ces coûts et engraisser les actionnaires.
Tant que les pharmas, la recherche, et tous les acteurs de l’industrie de la santé seront orientés vers un objectif de profit et de rentabilité, toute tentative de freiner les coûts de l’assurance de base seront infructueuses. Tant que les assureurs auront la possibilité d’engranger du profit sur les complémentaires, ils tenteront de limiter les soins remboursés par l’assurance de base. Tant que des écarts salariaux absurdes existeront dans la profession médicale, certains soins seront surfacturés et d’autres complètement dévalorisés. La population restera la vache à lait d’un secteur extrêmement rentable, payant pour des services de soin comme s’il s’agissait d’un bien de consommation comme un autre, voire d’un produit de luxe.
Les caisses d’assurance maladie sont parmi les grandes gagnantes du système sanitaire suisse. Alors que de la population renonce de plus en plus aux soins faute de moyens, la rémunération des dirigeants de ces dernières a explosé. Chez Sanitas, le directeur Andreas Schönenberger touchait 660 000 francs par an en 2016, un montant déjà obscène. Depuis, sa rémunération a grimpé à un million en 2023. Même mécanisme du côté du Groupe Mutuel, où le salaire du PDG Thomas Boyer a grimpé de 50% entre 2016 et 2023, atteignant 780 000 francs par année. Les directions gagnent toujours plus en remboursant toujours moins, s’enrichissant de fait sur la précarité sanitaire de la population. Mais pour parvenir à un niveau aussi élevé d’extorsion, ils ont besoin de soutien. Au parlement, nombreux sont les élus obéissant au doigt et à l’oeil aux caisses maladie. La gauche sociale-démocrate parle de lobbyisme, alors qu’il s’agit d’un mécanisme naturel: il est dans la nature de la démocratie bourgeoise de fonctionner comme outil de légitimation des intérêts capitalistes. Ainsi, de nombreuses initiatives visant à rendre plus social le système d’assurance maladie sont systématiquement contrées par la majorité de droite.
La classe politique suisse et les assureurs font tout pour cantonner le débat sur la question de l’augmentation des coûts de la santé, une manière habile d’esquiver un débat sur la mainmise bourgeoise sur ce système. Car l’autre vraie question n’est pas de savoir combien coûte de soigner la population, mais qui paie pour cela.
D’autres modèles de santé existent
Malgré ce que nous répètent les politiques et leurs gourous (assureurs maladie, milieux économiques, actionnaires, etc.), il existe des solutions à cette crise de la santé que nous subissons. Mais celles-ci nécessitent une remise en question profonde de notre modèle de financement et par conséquent de la logique économique sur laquelle s’est bâtie la Suisse. Difficile pour les dominants d’envisager qu’un autre monde est possible, lorsque cela entraînerait la fin du leur.
Plusieurs pays montrent l’exemple avec des modèles de soin plus justes. A quelques milliers de kilomètres de chez nous, la Roumanie a fait de la santé une priorité sociale. Cela signifie que le bien être de la population est considéré comme une thématique autant politique que médicale. Dans la constitution roumaine, il est rappelé que l’Etat a le devoir de fournir des prestations médicales à l’ensemble de la population. Ce système allant à l’encontre des modèles professés par l’Europe libérale est un héritage direct de l’URSS, où les coûts de la santé étaient entièrement pris en charge par l’Etat.
En Roumanie, de la médecine de premier recours aux soins ambulatoires en passant par les campagnes de dépistage, tout est pris en charge par les pouvoirs publics. Ce modèle protège les habitant.e.s de la prédation des privés. Proposer d’introduire un tel système en Suisse ferait bondir bon nombre de décideurs, qui ne manqueraient pas de déclencher une panique rouge. Le modèle roumain résulte pourtant d’une vision sociale-démocrate, qui ne met pas en danger la pensée libérale dominant en Europe. C’est d’ailleurs une limite importante à l’efficacité de ce système: en tolérant l’implantation des cliniques privées ou la concurrence des pays plus développés, une médecine à deux vitesses se crée de fait. La médecine d’inspiration socialiste ne peut prospérer que dans un modèle n’admettant aucun compromis avec le capitalisme.
C’est en partie ce que tente de maintenir Cuba, îlot socialiste au milieu d’une mer d’Etats américains ultralibéraux. Depuis la révolution cubaine de 1959, ce pays a réussi l’exploit d’avoir un meilleur système de santé que de nombreux pays occidentaux tout en subissant un blocus économique orchestré par les Etats-Unis et destiné à faire s’effondrer le régime socialiste de l’île.
Le système cubain repose sur un mélange de médecine de proximité décentralisée et une forte souveraineté scientifique. Grâce à des soins entièrement financés par l’Etat et une politique de prévention proactive, le pays avait en 2016 l’espérance de vie la plus élevée de toute l’Amérique latine (77 ans). L’île compte environ un médecin pour 147 habitants (1 docteur pour 1250 habitants en Suisse). De plus, Cuba dispose d’une forte industrie pharmaceutique. Les entreprises de fabrication de médicaments étant détenues par l’Etat, ce dernier conserve une souveraineté totale sur sa production. La spéculation sur le prix de certains médicaments y est totalement inconnue. C’est aussi un des premiers pays à avoir développé un vaccin lors de la pandémie de Covid-19.
Malheureusement, ce genre de modèle se fait de plus en plus rare. En France, la création de la sécurité sociale en 1945 (offrant aux cotisant.e.s une assurance maladie publique) fut une véritable révolution. Obtenu de haute lutte par les syndicats lors de l’entre-deux guerres, ce système consacrait à l’origine une gestion totale des cotisations par les ouvriers eux mêmes. A terme, l’entièreté de la population française devait être assujettie au même régime. Durant la guerre froide, ce fut un des systèmes s’approchant le plus du socialisme au sein du bloc capitaliste. La contre-offensive bourgeoise des années 80 a peu à peu démantelé ce mécanisme de solidarité. Il est aujourd’hui présenté comme un reliquat du passé, rappelant selon la bourgeoisie l’inefficacité de ce type de système. Ce sont pourtant les multiples attaques néolibérales qui ont petit à petit érodé sa capacité de redistribution.
En guise de conclusion
La santé nous est vendue à prix fort comme une marchandise soumise aux lois du marché, comme un investissement accessible aux classes les plus favorisées, alors qu’elle devrait être un droit universel. Faire reposer le coût des soins sur les patient.e.s pour au passage engraisser actionnaires et directions est un exemple flagrant de violence de classe. Seul un système prenant en charge l’intégralité des coûts médicaux par l’Etat permettra aux citoyen.ne.s de ne pas devoir s’exposer à la précarité pour être soignés ou pire, renoncer à des soins. Cela nécessite aussi de collectiviser la recherche et la production de médicaments, et de la mettre au service de la population plutôt que des actionnaires. Cela nécessite surtout un système économique global qui ne soit pas centré sur le profit de quelques-uns au détriment de tous les autres, et qui offre de bonnes conditions de vie à l’ensemble de sa population.
Nous sommes conscient.e.s qu’aucun vrai système de santé socialiste, avec au centre de ses préoccupations la santé effective de la population, ne peut émerger ou se maintenir au sein d’une économie capitaliste. Les différents exemples cités doivent nous rappeler que des alternatives pas si inconcevables existent et qu’une conception économique et libérale de la santé n’est pas une fatalité, mais le résultat politique de la mainmise de la bourgeoisie sur les institutions qui composent le système de santé suisse.
Aux Etats-Unis, pays dont le système sanitaire est pire qu’ici, Luigi Mangione a abattu en pleine rue le CEO d’une assurance santé, et la liesse populaire inattendue provoquée par cet exploit inquiète la classe capitaliste. Si un tel acte individuel ne suffit évidemment pas à renverser l’ordre établi, il a le mérite de s’inscrire radicalement hors de la politique parlementaire bourgeoise contrôlée par les lobbies, et de rappeler à tout un chacun que nous avons la capacité d’agir. Il ne s’agit pas, dans l’immédiat, de prendre les armes au sens propre: s’organiser, regrouper nos forces et combattre le capitalisme est un travail collectif de longue haleine, mais nous pensons que c’est le seul moyen d’infléchir la tendance et d’entrevoir la possibilité d’un avenir meilleur, d’une société où tout le monde aurait accès à des soins médicaux et à des conditions de vie dignes.
Ligne Rouge, janvier 2025
1. Toutes ces statistiques proviennent de l’Office Fédéral de la Santé Publique et de l’Office Fédéral de la Statistique, et sont trouvables sur le site internet de la confédération.